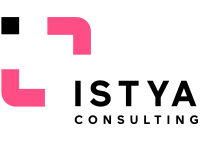Dans une tribune intitulée « Back to history », publiée par le journal Le Monde le 15 septembre 2001, Nicolas Baverez tirait les premiers enseignements des attentats ayant frappé les Etats-Unis quatre jours plus tôt. Ces propos restent d’un étonnante actualité et peuvent encore utilement nourrir la réflexion sur l’avenir que nous voulons pour notre continent dans le monde imprévisible, volatile et dangereux qui évolue sous nos yeux.
Son propos portait d’abord sur l’évolution de la menace : » […] passage du terrorisme de moyen de pression collatéral, instrumentalisé par les Etats, au statut de menace majeure, autonome et mondialisée […] La guerre moderne ne se fixe plus tant pour objectif la destruction des forces armées ou des infrastructures militaires que la panique des populations civiles et la désorganisation des réseaux qui innervent les sociétés complexes (places financières, systèmes d’information, réseaux de transport, flux énergétiques ».
Sa réflexion portait également sur l’évaluation des causes de la rupture stratégique que représentait alors la guerre portée au cœur même du continent nord-américain: » […] les démocraties […] ont délibérément placé le monde en pilotage automatique, au lieu de tenter d’élaborer les institutions et les règles nouvelles indispensables à la liberté dans le contexte d’une économie ouverte mondialisée et d’une société ouverte ». Et de dénoncer quatre illusions qui expliquaient alors très largement cette situation:
- « L’illusion technologique et libertaire célébrant Internet comme un espace émancipé de toute forme de régulation autre que technique et de toute contrainte de rentabilité »;
- « L’illusion économique et financière de la disparition des cycles et des crises, en raison de la promesse de gains de productivité infinis »;
- « l’illusion politique du dépérissement de l’Etat […] »;
- « l’illusion intellectuelle […] d’une auto-institution de la démocratie et d’une autorégulation du marché, érigées en lois ultimes de l’humanité ».
Cette tribune procédait également à quelques rappels salutaires qui continuent de structurer les relations humaines et nous rappellent que ce monde est intrinsèquement tragique :
- « L’histoire des hommes continue de s’écrire en lettres de sang »;
- « la violence et les guerres, les révolutions et les crises restent son moteur premier »;
- « la liberté est un combat permanent qui repose sur l’engagement des peuples et des nations démocratiques ».
Elle s’achevait sur quelques recommandations qui n’ont rien perdu de leur pertinence : « […] l’Europe doit réviser profondément ses modes de décision afin de se mettre en position d’intervenir dans la gestion des crises mondiales, économiques, diplomatiques ou militaires : mise en place d’un gouvernement économique et réforme de la Banque centrale européenne, création d’institutions communes en matière de sécurité intérieure de l’espace européen, hausse massive des budgets militaires, constitution d’une force rapide européenne bénéficiant de capacités autonomes de surveillance et de renseignement sont désormais prioritaires ».
» […] toutes les démocraties vont devoir réfléchir au réinvestissement des fonctions collectives, non seulement en termes financiers mais surtout en termes humains. Parallèlement, les nations libres, Etats-Unis en tête, devront rapidement mettre en place des organes de régulation communs pour gérer les risques liés aux mouvements de population, de capitaux, de technologies, d’armes de toute nature. »
Et de conclure, en forme de mise en garde : « Les Etats-Unis et les Européens ont dilapidé les chances de l’après-guerre froide. Ils vont désormais devoir se battre pour ne pas perdre l’après-après-guerre froide. Cela implique un réarmement non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan politique et moral avec la redécouverte de l’impérieuse nécessité des institutions et des normes pour la défense de la liberté, avec la réintégration de la vie publique dans le principe de responsabilité, avec le réinvestissement de citoyens dans la cité ».
C’était-il y a dix-huit ans … Je crois pour ma part très profondément avec Raymond Aron, dont nous gagnerions collectivement à relire l’œuvre, en la nécessité « d’apprendre ce qui dure pour comprendre ce qui change ». Posons-nous la question de savoir ce que nous, Européens, avons fait de notre talent depuis cette année noire …